Introduction
La photographe Marion Gronier a été choisie pour intégrer le programme 2024 de la résidence Elles & Cité, dédiée aux femmes photographes en milieu de carrière résidant hors de l’Île-de-France. Cette résidence de recherche lui a permis de développer sa série « Quelque chose comme une araignée », une exploration sensible et inédite du quotidien des personnes hospitalisées en psychiatrie en France et au Sénégal. Accompagnée par l’artiste et scénographe Jean-Christophe Lanquetin, Marion Gronier a affiné la mise en scène de son travail, qui vient d’être distingué par le Prix Photo Sociale. Son travail sera prochainement exposée à Toulouse et à Paris.
À retenir :
75010 Paris
En détails
© Marion Gronier / Lauréate du Prix Photo Sociale 2025
Marion, pouvez-vous présenter votre projet de résidence ?
Marion Gronier : J’avais déjà réalisé ce travail photographique dans des institutions psychiatriques en France, puis au Sénégal. Les images existaient, mais il me manquait cette phase essentielle de réflexion sur leur mise en forme et leur sens. Aborder un sujet aussi délicat nécessitait une réflexion approfondie sur la manière de le présenter. C’est précisément cet aspect que je souhaitais explorer au cours de cette résidence de recherche : inventer de nouvelles formes de monstration et de mise en scène. La Cité des arts m’a ainsi proposé un accompagnement avec Jean-Christophe Lanquetin, scénographe, afin de structurer cette démarche.
Jean-Christophe, vous êtes artiste et scénographe. Quel est votre retour d'expérience sur cette résidence ?
Jean-Christophe Lanquetin : En tant qu’enseignant dans une école d’art, j’accompagne chaque année une trentaine d’artistes. Cette résidence était différente, car le niveau d’expérience n’est bien évidemment pas le même qu’avec les étudiants, ce qui la rend d’autant plus passionnante ! Mon métier de scénographe me conduit à collaborer avec des artistes pour construire des dispositifs de monstration adaptés à leur travail. Ici, l’enjeu était d’inventer une forme qui résonne avec le sujet traité par Marion.
Comment s’est déroulée votre collaboration ?
M. G. : Nous avons d’abord échangé par téléphone avant le début de la résidence, afin de nous présenter et de poser les premières bases du projet. Ensuite, nous nous sommes rapidement rencontrés, et l’accompagnement s’est intensifié durant les trois mois de résidence. Lorsque Jean-Christophe était à Paris, nous organisions des entretiens de plusieurs heures. Entre ces rencontres, nous poursuivions les échanges à distance, par téléphone ou par e-mail, afin de suivre l’évolution du travail.
J.-C. L. : Après ces discussions préliminaires, nous avons entamé une phase de recherche et d’expérimentation directement au sein de la Cité des arts, dans les espaces sélectionnés par Marion pour travailler sur sa scénographie.
Votre objectif était de donner une forme à votre projet. Avez-vous quitté la résidence avec un travail finalisé ?
M. G. : Pas totalement, et c’est une chose que j’ai apprise grâce à Jean-Christophe : en scénographie, on travaille toujours en fonction d’un lieu précis. Il est essentiel de se projeter dans un espace réel et de mener une réflexion théorique avant de concrétiser la mise en scène. Cette résidence nous a permis de développer des idées, de construire une démarche et d’élaborer des dispositifs adaptables à différents lieux. Concevoir une scénographie sans espace défini reste un exercice délicat. Cette expérience m’a également beaucoup appris sur la manière d’appréhender l’espace. Jusqu’ici, j’avais rarement collaboré avec des scénographes ou des commissaires d’exposition, ce qui m’amenait à concevoir seule mes installations. C’était un processus complexe, que je trouvais difficile. Avec Jean-Christophe, nous avons travaillé sur une forme et une structure, mais elles restent en évolution. L’objectif est d’explorer toutes les potentialités qu’offre un espace pour une exposition.
J.-C. L. : Il s’agissait avant tout d’un processus expérimental. L’enjeu n’était pas de concevoir une scénographie définitive, mais d’ouvrir des pistes et d’engager une réflexion qui amène Marion à faire des choix, comme sélectionner ses images. Comme elle l’a souligné, le projet n’est pas encore achevé, mais il pourra se reconfigurer et se redéployer dans d’autres contextes d’exposition. En revanche, le travail de réflexion sur le corpus photographique a bien avancé.
Avez-vous également expérimenté de nouveaux supports, notamment en matière de tirage ?
M. G. : C'est à ce niveau que j'ai expérimenté et mis en place de nouvelles choses, en montrant par exemple une partie du travail sous forme de projection, un format qui apporte une dimension différente au travail. Cette réflexion sur le support a été enrichie par mes échanges avec Jean-Christophe. Nous avons également décidé d’intégrer des éléments sonores en enregistrant des témoignages de patients et patientes dans les institutions où j’avais réalisé mes prises de vue. L’idée était de leur montrer mes photographies et de recueillir leurs interprétations. Ce dispositif sonore constitue désormais une part importante du projet. Il permet d’impliquer activement les personnes photographiées et de ne pas les réduire au simple statut de sujets d’image.
Quelle est la suite pour ce projet ?
M. G. : La série sera exposée à l’automne 2025 au musée Nicéphore Niépce, dans le cadre de l’exposition « Face à ce qui se dérobe, les clichés de la folie ». Elle sera présentée aux côtés de tirages issus des collections du musée, ce qui apportera une nouvelle mise en perspective du travail. Un livre est également en préparation avec les éditions du Bec en l’Air, à paraître en octobre prochain. Tout ce que j’ai développé durant la résidence s’avère précieux pour la conception de la maquette de l’ouvrage. Par ailleurs, je poursuis le travail d’enregistrement des témoignages de patients afin d’enrichir la série.
Quel bilan tirez-vous de cette résidence ? Quels conseils donneriez-vous aux femmes photographes intéressées par ce programme ?
M. G. : Cette résidence a été une expérience très enrichissante. Elle m’a permis de travailler avec Jean-Christophe, mais aussi de rencontrer Alexandra Pouzet, autre lauréate du programme, avec qui j’ai noué une belle relation amicale et artistique.
Je recommande vivement cette résidence aux femmes photographes, car elle permet de progresser rapidement sur un projet et d’explorer de nombreuses pistes en peu de temps. L’organisation est particulièrement bien pensée. J’aurais peut-être aimé que la restitution s’étende sur une durée plus longue, afin d’avoir davantage de temps pour rencontrer des professionnels en rendez-vous individuels.
Elles & Cité est un programme de résidences de recherche et de création dédié aux femmes photographes en milieu de carrière, basées en dehors de la région Ile-de-France. A l’initiative et avec le soutien du ministère de la Culture et de la Cité internationale des arts, Elles & Cité reçoit également le soutien de la Fondation d’entreprise Neuflize OBC et de l’ADAGP.
Autrices, Auteurs
Ericka Weidmann





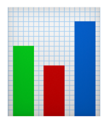

 Temps de lecture :
Temps de lecture :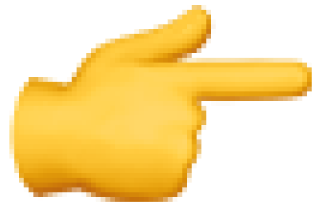 Objectifs :
Objectifs :